
Personne n’est à l’abri d’un accident vasculaire cérébral (AVC ou encore attaque cérébrale) – soudainement, sans signe préalable. Pourtant, venir rapidement en aide peut sauver des vies et éviter les séquelles. PD Dr med. Timo Kahles, chef de la clinique de neurologie et co-directeur du Stroke Center au Kantonsspital Aarau AG (hôpital cantonal d’Argovie), nous explique comme reconnaître un accident vasculaire cérébral, ce qu’il faut faire en cas d’urgence – et pourquoi l’imagerie moderne peut sauver des vies, même lorsque des AVC se produisent en pleine nuit sans se faire remarquer.
Monsieur Kahles, à quoi reconnaît-on un accident vasculaire cérébral? Quels sont les symptômes particulièrement alarmants?
En général, un AVC survient subitement. En fonction de la localisation de la lésion, les signes d’alerte peuvent se manifester sous différentes formes: hémiplégie ou trouble sensitif, déformation de la bouche et troubles de la parole ou de l’élocution. Des troubles de la vision ou de l’équilibre peuvent également annoncer un AVC. Des maux de tête soudains et violents, un peu comme un «coup de tonnerre», peuvent être des signes précurseurs d’un AVC. De manière générale, on notera que les symptômes n’apparaissent que d’un côté du corps et subitement – un signal d’alerte important.
Quels sont les différents types d’accidents vasculaires cérébraux et en quoi se distinguent-ils les uns des autres?
Dans le cas des AVC ischémiques, un vaisseau sanguin est obstrué dans le cerveau – le plus souvent par un caillot de sang (thromboembolie) ou rétréci à la suite d’une athérosclérose. Environ 85 pour cent des attaques cérébrales font partie de cette catégorie. En revanche, dans le cas des AVC hémorragiques, une rupture de vaisseau entraîne un épanchement de sang soit dans le tissu cérébral (hémorragie intracérébrale), soit, plus rarement entre les méninges (hémorragie sous-arachnoïdienne).
Etant donné que les symptômes de ces deux types se ressemblent fréquemment, l’imagerie rapide moyennant la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est indispensable pour identifier exactement la cause. Cette différence est également décisive pour le traitement. Les petites différences, néanmoins décisives sur le plan thérapeutique, soulignent l’importance des centres spécialisés dans le traitement des attaques cérébrales (Stroke Units et Stroke Centers) dans lesquels est effectué dans les plus brefs délais un examen structuré – de l’examen clinique à l’imagerie haute résolution. Chaque minute compte et le transport précoce assuré par les services de secours (numéro d’urgence 144) vers un centre approprié peut décider de la vie du patient ou de la patiente, du fonctionnement des organes et de la qualité de vie.
Pourquoi le temps est-il un facteur aussi essentiel en cas d’accident vasculaire cérébral?
Le temps est un facteur clé en cas d’accident vasculaire cérébral. Dans le cas d’un AVC ischémique, c’est-à-dire lorsqu’un vaisseau sanguin est obstrué, le tissu cérébral sous-jacent est sous-alimenté en oxygène et nutriments et le tissu commence à mourir. Plus le vaisseau obstrué est réouvert rapidement, plus les chances sont grandes de pouvoir sauver le tissu cérébral concerné. Dans le cas d’un AVC hémorragique, le temps est très important pour éviter une hémorragie encore plus importante ou, si l’hémorragie est déjà importante, de soulager rapidement.
Test (BE-)FAST permettant d’identifier un accident vasculaire cérébral
- «B» pour Balance – troubles de l’équilibre, vertiges
- «E» pour Eyes – troubles de la vision d’un ou des deux côté(s), images dédoublées
- «F» pour Face – visage. Immobilité d’un coin de la bouche d’un seul côté lorsque la personne essaie de sourire.
- «A» pour Arm – un bras retombe lorsque la personne essaie de lever les deux bras.
- «S» pour Speech – parole, élocution. Troubles de la parole et de l’élocution.
- «T» pour Time – car le temps est décisif.
Que devrait-on faire en tant que secouriste en cas de soupçon d’accident vasculaire cérébral?
Le plus important est de composer immédiatement le numéro d’urgence 144 pour que le diagnostic spécifique et le traitement puissent être établis rapidement. Les secouristes devraient par ailleurs examiner si la personne concernée est consciente, si elle respire normalement et si le pouls est perceptible. Si la personne est inconsciente, il convient de la mettre en position latérale de sécurité. Il est également important de ne pas lui donner à boire ou à manger – et de ne pas lui administrer de médicaments anti-coagulants comme l’aspirine.
Pourquoi ne doit-on pas donner d’aspirine?
Sans imagerie, on ne peut dire avec certitude s’il s’agit d’une hémorragie ou de l’obstruction d’un vaisseau. En cas d’accident vasculaire cérébral hémorragique, c’est-à-dire d’une hémorragie cérébrale, l’aspirine peut aggraver sensiblement la situation car elle inhibe la coagulation du sang.
Doit-on placer une victime d’AVC dans une position donnée ou lui donner à boire par exemple?
En général, on laisse la personne allongée sur le dos. En cas de vomissements ou d’évanouissement, il faut la placer en position latérale de sécurité; si elle souffre de problèmes cardiaques / de détresse respiratoire aiguë, en position semi-assise. Il est important de ne pas paniquer et de rassurer la personne – cela peut permettre de réduire d’éventuels problèmes respiratoires. En revanche, mieux vaut renoncer à donner à boire ou à manger, entre autres car il n’est pas rare que les personnes concernées aient des problèmes de déglutition.
Quel rôle les anti-coagulants jouent-ils dans le traitement aigu?
Lorsqu’il s’agit d’AVC ischémiques – donc de ceux causés par l’obstruction d’un vaisseau sanguin dans le cerveau –, la thrombolyse dite intraveineuse est un élément central du traitement aigu. Dans les quatre heures et demie qui suivent l’apparition des premiers symptômes, il est injecté un médicament anti-coagulant dans une veine pour restaurer le débit sanguin le plus vite possible dans la zone touchée.
En cas d’obstruction d’artères cérébrales, il est possible d’effectuer en plus ou à la place, dans les huit heures qui suivent l’apparition des premiers symptômes, un traitement endovasculaire au moyen d’un cathéter cérébral.
Dans les Stroke Units et les Stroke Centers, nous pouvons, à l’aide d’images en coupe spéciales du cerveau, identifier les patients susceptibles de profiter d’un traitement aigu en dehors du créneau rigide de quatre heures et demie ou de huit heures ou lorsque l’on ne sait quand sont apparus les premiers symptômes.
Quel est le risque de récidive?
Une personne atteinte sur huit environ subit un nouvel accident vasculaire cérébral dans les cinq ans suivant le premier – le risque étant particulièrement élevé durant la première année qui suit l’accident. Pour cette raison, il est de coutume de procéder à des contrôles de suivi au bout de trois mois et d’un an pour contrôler la progression d’une athérosclérose des artères qui irriguent le cerveau, certains troubles du rythme cardiaque comme une fibrillation auriculaire, de même que l’évaluation optimale des facteurs de risque tels que l’hypertension artérielle, le cholestérol ou le tabagisme. Il est ici à la fois précieux et important de coopérer étroitement avec les cabinets médicaux, et plus particulièrement avec les médecins généralistes et les cardiologues.
Les mini-AVC ou les accidents ischémiques transitoires (ATI) – soit des troubles transitoires de la circulation sanguine sans séquelles – sont des signes avant-coureurs et doivent être également pris au sérieux et examinés en détail. Ils donnent un créneau important pour la prévention d’accidents plus graves et devraient également être systématiquement diagnostiqués et traités dans des centres spécialisés.
Comment prévenir un accident vasculaire cérébral?
L’accent est mis d’une part sur l’évaluation optimale des facteurs de risque vasculaires et d’autre part sur le traitement ciblé de causes spécifiques.
Contrairement aux facteurs de risque sur lesquels il n’est pas possible d’agir, tels que l’âge, le sexe, la prédisposition génétique et l’origine ethnique, l’évaluation optimale des facteurs de risque sur lesquels il est possible d’agir, notamment l’hypertension artérielle et la réduction d’une consommation de nicotine, contribue largement à la prévention d’un accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, l’évaluation d’un diabète sucré et de valeurs élevées de cholestérol ainsi que la réduction d’une surconsommation d’alcool, sont importantes. Une activité physique régulière – une promenade quotidienne ou un entraînement modéré à l’endurance suffisent déjà – et une alimentation équilibrée, de préférence de type méditerranéen, contribuent largement à la réduction du risque. Cette alimentation se caractérise par une part élevée de fruits, de légumes, de produits complets, d’acides gras insaturés (p.ex. issus d’huile d’olive ou de fruits à coque) et peu de viande rouge. Des études montrent qu’en combinant ces mesures on peut réduire le risque d’attaque cérébrale jusqu’à 80 pour cent – un résultat impressionnant.
Après avoir subi un accident vasculaire cérébral, il convient d’identifier la cause précise de l’événement afin d’éviter une récidive. Il s’agit d’examiner les troubles du rythme cardiaque, tels que la fibrillation auriculaire, qui peuvent faire l’objet d’un traitement médicamenteux, tout comme le rétrécissement d’artères carotides (sténoses carotidiennes) qui, dans certains cas, devrait être opéré ou traité au moyen de stents.
Que se passe-t-il si un accident vasculaire cérébral n’est pas identifié et traité en temps requis?
Un accident vasculaire cérébral qui n’est pas traité rapidement peut laisser des séquelles lourdes: la moitié environ des patients et patientes s’en remet bien grâce aux gros progrès réalisés dans le traitement des AVC. Toutefois, un tiers souffre d’affectations durables et env. 15 pour cent des personnes atteintes décèdent. Plus le traitement commence tôt – de préférence dans les quatre heures et demie suivant l’événement –, plus les chances de récupération sont bonnes.
Les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent en plein sommeil sans être remarqués sont de véritables défis. Un quart environ des patients et patientes ne remarquent les symptômes que le matin lorsqu’ils se réveillent. Etant donné que c’est l’heure à laquelle est constaté le dernier état normal – le plus souvent au moment de se coucher – qui compte, de nombreux patients et patientes sortent formellement du créneau de traitement. Grâce à l’imagerie moderne, il est aujourd’hui souvent possible, indépendamment de l’heure, d’évaluer si l’on peut encore sauver du tissu cérébral. Ainsi, ces patients et patientes peuvent profiter d’un traitement ciblé – un gros progrès réalisé ces dernières années.
Existe-t-il de nouvelles approches de traitement moderne de l’accident vasculaire cérébral?
Oui, on travaille actuellement sur de nombreuses innovations – par exemple sur ces unités mobiles de TDM dans les ambulances, sur des interventions par cathéter télécommandées ou encore sur des marqueurs sanguins et des biomarqueurs d’imagerie dans le but d’améliorer le diagnostic et la prévention. Le développement de meilleurs médicaments, par exemple pour réduire les réactions inflammatoires dans le cerveau ou contribuer à la réadaptation neurologique, sont des questions passionnantes.
Et après l’accident vasculaire cérébral? Quelles sont les mesures de soutien proposées aux personnes concernées et aux proches?
La phase suivant le traitement aigu est pleine de défis pour de nombreuses personnes concernées – sous l’angle physique, émotionnel et social. Cela explique pourquoi la réadaptation neurologique prend de plus en plus d’importance. L’objectif est de promouvoir l’autonomie, d’améliorer la qualité de vie et de réintégrer les personnes concernées dans le quotidien, le milieu familial ou la vie professionnelle.
Alors que le traitement aigu des AVC, la prévention secondaire, la réadaptation neurologique et le suivi médical sont déjà des piliers bien établis du traitement global des AVC, l’aspect «Life After Stroke» – Vivre après une attaque cérébrale – revêt de plus en plus d’importance. Le besoin d’interlocuteurs et d’interlocutrices et d’offres de soutien (sur le plan social, psychologique et au quotidien) à la sortie du traitement stationnaire est grand.
C’est ici qu’interviennent des organisations de patients et patientes et des réseaux. La Fondation suisse de Cardiologie propose des informations détaillées, des conseils et un soutien pour les personnes concernées et les proches – depuis des brochures jusqu’à des cours de réadaptation. L’association FRAGILE Suisse s’investit également et s’est spécialisée dans l’accompagnement de personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral et d’autres lésions cérébrales. Les deux organisations proposent également des groupes d’entraide autogérés et des programmes de pair à pair dans lesquels des personnes qui ont fait des expériences similaires fournissent un soutien précieux – souvent d’égal à égal et en faisant preuve d’une grande compréhension. Fragile Suisse a récemment lancé le projet LOTSE (Un guide à vos côtés) qui accompagne et soutient les personnes atteintes et les proches lors du passage du traitement stationnaire au suivi médical et comble ainsi la lacune entre le traitement stationnaire et ambulatoire.
Ces offres sont très bien accueillies car il est plus facile de relever en commun les nombreux défis – de la réinsertion aux problèmes de tous les jours. Lors des contrôles dans les services ambulatoires des Stroke Units et des Stroke Centers ainsi que dans les cabinets de médecine générale, on veille de plus en plus à attirer l’attention des personnes concernées sur de telles offres et à les conseiller en cas de besoin.
Le nombre d’accidents vasculaires cérébraux a-t-il évolué en Suisse au cours des dernières années?
Oui, le nombre absolu d’accidents vasculaires cérébraux a légèrement augmenté et s’établit à un peu plus de 20’000 AVC par an. Cette évolution s’explique d’une part par la croissance démographique et le vieillissement de la population, d’autre part par l’amélioration des diagnostics et le fait que de plus en plus de personnes concernées peuvent se rendre et se faire traiter dans un hôpital spécialisé.
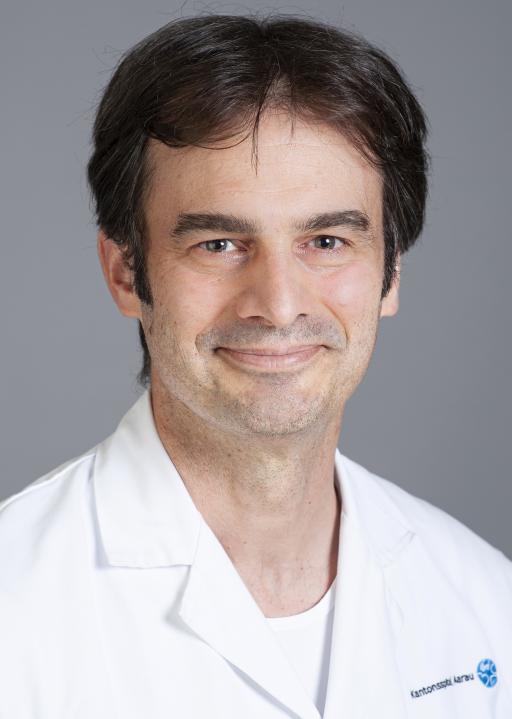
PD Dr med. Timo Kahles, Kantonsspital Aarau AG
Chef de la clinique de neurologie
Co-directeur du Stroke Center



